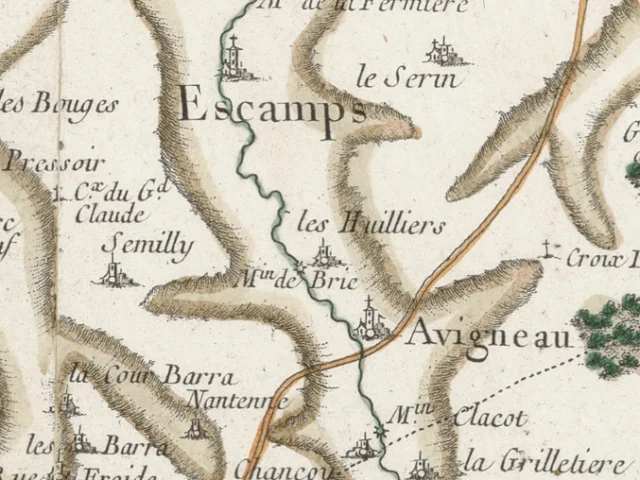L’histoire du bourg de Coulanges démarre dès le IIe de notre ère, quand les Romains vont y implanter les premières vignes dans l’Auxerrois, en cépage rouge. Rome va alors baptiser ce territoire Colongiae Vinosiae , qui peut se traduire littéralement en « colonie vineuse ».
Le bourg va alors devenir au Moyen âge une puissante seigneurie viticole et va développer sur son territoire un vignoble de qualité et une culture de la céréale foisonnante. Coulanges incorpore dans son nom ce lieu à la terre, à travers le mot « lès » signifiant « près de ». Coulanges-lès-Vineuses est ainsi dès la fin du Moyen Age, caractérisé par son importante activité viticole.
La population se développant rapidement et de façon très prospère, une enceinte fortifiée est édifiée autour du bourg perché, vers 1458. Les temps sont troubles durant le Moyen Age et la Renaissance, Coulanges subit le poids de l’Histoire avec la guerre de Cent Ans et les Guerres de Religion. En 1568, le prince de Condé obtient la reddition de la seigneurie viticole après le massacre d’Irancy. La seigneurie de Coulanges appartient alors au XVIe, à la famille des Beauvoir de Chastellux, qui maintient difficilement la ville dans le giron catholique. Les attaques des Huguenots se multiplient et Coulanges est souvent lourdement rançonnée. Au moment de l’assassinat d’Henri III, des royalistes d’Auxerre se retirent de la cité épiscopale et occupent Coulanges. Pour se libérer de la menace, la Ligue vient assiéger le château et y massacrer une partie de ses adversaires le 4 juin 1589
 Coulanges La Vineuse Vue Vignes et Villages
Coulanges La Vineuse Vue Vignes et Villages Coulanges Rotated
Coulanges Rotated Floraison, Cerisiers De Coulanges La Vineuse André Hulnet Min
Floraison, Cerisiers De Coulanges La Vineuse André Hulnet Min